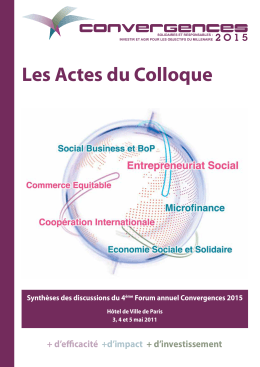Avertissement Le contenu de cette publication n’engage en aucune façon l’Union Européenne. Elle est le fruit d’observations des acteurs du terrain et de la capitalisation d’une décennie de travail dans le delta du fleuve Sénégal. La réalisation de cette publication a été possible grâce au travail et à l’engagement d’un collègue et amis, Enrico Luzzati, profond connaisseur de l’ASESCAW et de la zone du delta Préparée par : Simona Guida, Andrea Bessone, Djibril Diao, Mohamedine Diop Coordination rédactionnelle : Simone Pettorruso, Edouard Junior Ndeye Rédaction : Ousseynou Mbodji, Amadou Diop, Maimouna Sarr avec la collaboration de Francesco Abbate, Université de Turin Editing : Edouard Junior Ndeye Photos : Sergio Casu, Simone Pettorruso Imprimerie : La Rochette Comptoir Graphique - Dakar Sommaire Avant Propos ..................................................................................................................................... 05 Introduction ....................................................................................................................................... 06 CHAPITRE I : Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve ....................... 07 CHAPITRE II : L’ASESCAW et son intégration dans l’espace socioéconomique et politique local ................ 10 CHAPITRE III : Les services à la production agricole ........................................................................................... 13 Le financement agricole promu par l’ASESCAW : le dispositif Mec Delta ............................... 14 Les magasins/centres commerciaux agricoles (CCA) ............................................................... 16 CHAPITRE IV : L’articulation entre les acteurs du modèle (OP, IMF, CCA).......................................................... 17 CHAPITRE V : Le Système d’information de marché (SIM). Organisation, utilités et perspectives ................ 19 Conclusions ...................................................................................................................................... 22 04 - Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz Acronymes ASESCAW Amicale Socio Economique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Waalo CNCAS Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal. CAPS Centrale d’Approvisionnement et de Prestations de Services CCA Centres Commerciaux Agricoles CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato CMS Crédit Mutuel du Sénégal DPS Direction de la Prévision et des Statistiques GIE Groupement d’Intérêt Economique GEC Groupement d’Epargne et de Crédit IMF Institutions de Micro finance MEC Mutuelle d’Epargne et de crédit NPA Nouvelle Politique Agricole ONG Organisation Non Gouvernementale OP Organisation Paysanne PAAZ Programme d’Amélioration Agro Zootechnique PME Petite et Moyenne Entreprise PASA Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire dans la vallée du Fleuve Sénégal par la promotion des services à la production agricole SFD Systèmes Financiers Décentralisés SAED Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz - 05 Avant Propos CISV et ASESCAW ont entamé depuis une dizaine d’années un parcours commun visant à intervenir sur les différentes questions de la lutte contre la pauvreté, de la promotion de la souveraineté alimentaire et de l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans la zone d’intervention de l’ASESCAW, dans le Nord du Sénégal. La zone est caractérisée par une forte vulnérabilité de la population, du fait du manque de revenus stables et des difficultés à promouvoir un développement durable et profitable au milieu. Suite à l’échec dans les années passées des interventions basées sur une approche topdown et au processus de désengagement de l’Etat au cours des années ‘90, les organisations paysannes comme ASESCAW ont appuyé les populations locales pour la recherche d’un développement endogène adapté à leurs nécessités. A cet effet, ASESCAW et ses partenaires ont relevé le défi, en mettant en place un système de soutien à la production, à la commercialisation et au financement qui est fortement innovant. Ce modèle se base sur l’appropriation par les producteurs des structures mises en place, sur le développement des synergies entre elles et sur l’enracinement de ces structures au niveau de la localité, afin de répondre convenablement aux préoccupations des différentes catégories de producteurs locaux. Dans ce cadre, la stratégie du partenariat entre CISV et ASESCAW vise à atteindre des objectifs ambitieux à travers la reconnaissance et le renforcement du rôle que les organisations paysannes doivent jouer dans l’autonomisation et la durabilité du processus productif. La centralité du rôle de ces organisations se révèle dans tous les domaines du développement du territoire et veut favoriser les synergies pour résoudre les problèmes majeurs rencontrés par les paysans. En particulier, au centre de cette stratégie on trouve les foyers des producteurs, organisations à caractère coopératif, enracinées dans leur milieu, définies par leurs propres histoires et caractéristiques, représentatives d’une partie significative de la société civile. On peut sans doute affirmer que les foyers ont acquis au fil du temps des compétences techniques importantes, mais il faut noter qu’ils n’ont pas encore atteint le degré de structuration nécessaire à garantir une gestion efficace des ressources. A partir de ces considérations, CISV et ASESCAW ont retenu de favoriser le développement d’activités génératrices de revenus, à travers l’appui aux emplois productifs sur la base d’un modèle équitable et équilibré, grâce au renforcement des capacités des organisations de base, au financement de l’agriculture, à l’amélioration de l’approvisionnement et de la commercialisation des produits agricoles. Ce processus encourage les liens entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux nécessaires pour impulser une dynamique de développement durable. Le soutien institutionnel et le renforcement des capacités des organisations de producteurs membres de l’ASESCAW pour améliorer leur organisation interne et renforcer leurs capacités, sont enfin au centre des actions réalisées. D’une manière générale, les initiatives menées par CISV et ASESCAW sont basées sur la participation active de l’ensemble des acteurs de la zone, dans le cadre d’une approche d’appui au développement local, qui utilise comme “porte d’entrée” les organisations paysannes. Les initiatives conjointes de CISV et ASESCAW ont visé la mise en place et l’accompagnement de structures indépendantes du point de vue technique, financier et gestionnaire, mais émanant de la même base associative. Le protagoniste de cette stratégie est donc en premier lieu le mouvement paysan, représenté dans cette zone par l’organisation ASESCAW, mais implique en même temps des autres sujets tels que les institutions de microfinance, les centres commerciaux agricoles, les partenaires au développement qui agissent dans la zone. Dans le but de capitaliser une partie du parcours fait ensemble, nos organisations présentent aujourd’hui cette publication qui résume non seulement les actions réalisées dans le cadre de notre partenariat, mais qui veut présenter un système d’appui aux producteurs qui représente un modèle pleinement endogène et une réponse concrète aux grands défis du monde rural. Ce système n’est pas à considérer comme un acquis définitif, mais plutôt comme un point de départ sur lequel on doit s’engager davantage et qui doit être capable de s’améliorer et s’adapter pour répondre aux nécessités des nos sociétés en rapide évolution. La CISV est une ONG italienne qui depuis 35 ans lutte contre la pauvreté et pour les droits des populations dans le monde, en favorisant le développement des communautés locales en appui aux organisations de base endogènes. CISV soutient des initiatives dans les secteurs de la micro-finance rurale, des ressources hydriques, de l’agro-zootechnie, des droits, de la formation professionnelle et de l’interculture dans 11 pays de l’Afrique et de l’Amérique Latine. En Italie, elle œuvre sur le front de l’éducation dans les écoles et des campagnes de sensibilisation et information sur le thème du développement en collaboration étroite avec d’autres associations de la société civile parmi lesquelles celles des ressortissants. La CISV intervient au Sénégal depuis 1988 en partenariat avec les organisations de base, en particulier avec les organisations paysannes à travers une approche de développement local, en facilitant la mise en œuvre de réseaux d’acteurs dans les régions de Louga et Saint-Louis. L’ASESCAW est une fédération de 176 associations villageoises, réparties dans les départements de Louga, Saint-Louis et Dagana. Parmi les objectifs de l’ASESCAW, on peut noter la formation morale et intellectuelle des populations à la base et la lutte contre la pauvreté et toutes formes d’inégalité et d’exclusion. L’ASESCAW a initié plusieurs programmes de promotion du monde rural et a développé des innovations majeures dans les domaines de l’irrigation, de l’approvisionnement en intrants agricoles, du financement agricole et rurale, de la promotion de la femme rurale, de la lutte contre l’exode rurale et de la gestion des ressources naturelles. Elle a été à la base de la construction du mouvement paysan sénégalais dont elle fait partie des plus grands piliers. Les Présidents CISV et ASESCAW Piera GIODA et Babacar DIOP 06 - Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz Introduction La présente publication n’envisage pas uniquement l’exposition des acquis du « Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire dans la vallée du Fleuve Sénégal par la promotion des services à la production agricole » (PASA), réalisé par la CISV en partenariat avec l’ASESCAW, grâce au cofinancement de l’Union Européenne, mais aussi les caractéristiques de ce qu’on peut appeler un véritable système d’acteurs opérant pour le développement du monde rural. En effet, l’intervention du projet a été conçue et réalisée en tenant compte des potentialités dérivant de l’existence de plusieurs structures indépendantes, mais étroitement liées du fait du partage de la même base associative, qui sont nées de l’initiative du mouvement paysan local dans le contexte du Delta du fleuve Sénégal. L’action cofinancée par l’Union Européenne a été la suite naturelle d’un projet cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères italien, réalisé entre 2004 et 2007, ayant pour but l’amélioration des conditions de sécurité alimentaire de la zone. En travaillant au niveau du projet précédent, la CISV et l’ASESCAW ont pu démarrer le renforcement d’un véritable « district communautaire coopératif », où plusieurs structures à base coopérative étaient en train de travailler au niveau de la vallée du Fleuve en faveur du monde rural. D’un coté les producteurs agricoles, structurés autour d’associations à but productifs, les foyers et les groupements villageois, adhérant à la fédération ASESCAW. De l’autre coté, certaines institutions de microfinance (IMF), évoluant dans la localité pour fournir des services financiers de proximité pour l’agriculture. Finalement, les magasins/centres commerciaux agricoles (CCA), ayant comme mission la fourniture d’intrants pour l’agriculture, tout en intégrant parmi leurs services certaines prestations mécanisées. Il s’avère important remarquer que soit les IMF, soit les magasins en question étaient promus, suivant différents parcours, par l’organisation faitière ASESCAW, c’est-à-dire par le même mouvement paysan. Ainsi, d’une manière complémentaire au projet antécédent et en soutenant le parcours déjà entamé, l’ASESCAW, accompagné par la CISV, a voulu concentrer son attention à travers le PASA sur le développement des services à la production agricole, y compris le financement de l’agriculture, la disponibilité d’intrants et la commercialisation de produits agricoles au bénéfice des paysans. La stratégie adoptée pour atteindre les objectifs fixés passait par la reconnaissance et par le renforcement du rôle que les organisations paysannes doivent jouer dans l’autonomisation et la durabilité du processus productif. La mise en place et l’accompagnement de structures indépendantes du point de vue technique, financier et gestionnaire, mais émanant de la même base associative a permis le développement des synergies nécessaires pour résoudre les problèmes majeurs rencontrés par les producteurs. Le projet a promu le développement d’organisations à caractère coopératif, enracinées dans le milieu et représentatives d’une partie significative de la société civile. En effet, dans la zone ciblée, caractérisée par la présence de périmètres irrigués, aptes à la production de riz et de maraîchage utilisant l’eau du fleuve Sénégal pour l’irrigation, les producteurs ont acquis au fil du temps des compétences techniques importantes, mais ils n’avaient pas encore atteint le degré de structuration nécessaire à garantir une gestion efficace des ressources disponibles localement. Pour cela, les axes sur lesquels le Projet a opéré ont été principalement : le renforcement des capacités des organisations de producteurs, l’amélioration de l’approvisionnement et de la commercialisation des produits agricoles, le financement de l’agriculture. Le renforcement organisationnel et institutionnel de ces acteurs et l’amélioration de la qualité des services aux producteurs a été la méthode qui a permis d’augmenter stablement les revenus des paysans. L’action s’est activée en soutenant cette partie du monde paysan local à plusieurs niveaux, notamment à travers le renforcement institutionnel des organisations des producteurs en tant qu’acteurs du développement, par l’établissement d’un plan stratégique de développement durable, la formation des cadres et du personnel, la dotation d’outils et moyens conséquents pour la réalisation de leur mission. En outre, elle a procédé à la création et au renforcement de structures qui gèrent des services capitaux en amont et en aval de la production, par le biais de la sécurisation des services, le renforcement de capacités des élus et du personnel, la dotation d’instruments de gestion fiables, l’attribution du rôle d’antennes sur les marchés. En suite, le projet s’est concentré sur le renforcement institutionnel de sept IMF, à travers la construction ou la réfection des sièges, l’amélioration des capacités des élus et du personnel, l’augmentation des garanties de contrôle interne, la promotion de la concertation en vue d’un processus de réseautage. Finalement, il a renforcé le rôle d’orientation stratégique des OP au profit des synergies locales, par la constitution d’un Cadre de Concertation Permanent entre les OP, les magasins et les IMF. D’une manière générale le projet s’est basé sur la participation active de l’ensemble des acteurs de développement de la zone, dans le cadre d’une approche d’appui au développement local, qui a utilisé comme “porte d’entrée” les organisations paysannes. Afin de mieux comprendre les contours du système promu par le projet et ses caractéristiques essentielles, nous procéderont d’abord avec une brève analyse du contexte et des principales problématiques de la localité. En suite, nous analyserons l’historique de l’ASESCAW et son intégration dans les espaces socioéconomiques et politiques de la Vallée du Fleuve. Cette partie nous permettra aussi d’aborder la description du premier pilier du système, à savoir celui des organisations chargées de la production agricole proprement dite. Le troisième chapitre portera, par contre, sur les services agricoles (approvisionnement en intrants, prestations mécanisées, stockage, transformation et commercialisation de la production) et le système financier. C’est au niveau du quatrième chapitre que nous traiterons de l’articulation entre les différents acteurs actifs au niveau du modèle, ainsi que les synergies y afférant. Pour conclure, le cinquième chapitre offrira un focus sur le système d’information des marchés (SIM) mis en place au sein des magasins. Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz - 07 CHAPITRE 1 Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve 08 - Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz Entre le Diéri, zone sèche favorable à l’élevage, et le Walo, zone agricole inondable aux terres fertiles et aux sols argileux, où se pratiquent principalement la riziculture irriguée et le maraichage, se succèdent des villages peuls, wolofs et maures. Le Département de Dagana, principale zone d’intervention de l’ASESCAW, est une grande étendue d’environ 5.200 km². Le Delta du Fleuve Sénégal, situé au Nord du Sénégal, jouxtant le Mali et la Mauritanie, couvre la Région administrative de Saint-Louis et la Région de Tambacounda. La Région de Saint Louis, notamment le Département de Dagana, est caractérisée par la présence du bassin versant du fleuve Sénégal, qui totalise 220.000 km² (dont 60.000 km² en territoire sénégalais) et qui révèle un territoire riche en eau. Au niveau de la démographie, la population du département est estimée à 192.984 habitants (à majorité wolof, 70%), dont les 63% sont ruraux. Le milieu naturel y est très spécifique. La pluviométrie est dans l’ensemble très faible et dépasse rarement les 300 mm/an. Le Delta est situé aujourd’hui au centre des enjeux de l’agriculture sénégalaise du fait de la présence du fleuve Sénégal et des grands aménagements réalisés depuis la période coloniale par l’Etat. Les aménagements hydro agricoles ont d’abord consisté de grands périmètres publics (réalisés à partir des années ’60) auxquels sont venus s’ajouter les périmètres gérés par les organisations paysannes. Cette dernière catégorie de périmètres est conçue de manière très simple et à de faibles coûts. Les périmètres conçus par les organisations paysannes (comme l’ASESCAW) sont plus accessibles, même si l’absence d’un réseau de drainage accroît dans certains cas le taux de présence de sel. Toutefois, la comparaison des rendements observés entre les deux typologies montre l’inadéquation des grands périmètres publics. Pour un coût très élevé, les rendements ne sont améliorés que d’environ 25%. L’agriculture irriguée se caractérise aujourd’hui par le désengagement presque total de l’Etat, la réorganisation et la réadaptation des cultures au nouveau contexte, la diversification de la production (qui inclue de plus en plus le maraichage, pratiquée en contre saison froide), le développement de stratégies paysannes pour promouvoir la vente de leurs produits, la diversification de leurs revenus, ainsi que la qualité des produits qu’ils mettent sur les marchés. Pour ce qui concerne la filière riz (qui est la plus rependue), la promotion de la production rizicole locale pour satisfaire les besoins nationaux toujours croissants et jusqu’à nos jours dépendants du marché international relève d’une option stratégique de l’Etat. En effet, avec une consommation de riz entre 60 et 70 kg/hab/ an (en moyenne 600.000 tonnes), seulement de 20 à 30% sont couverts actuellement par la production nationale. La mondialisation de l’économie, soulignée par la mise en œuvre des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a constitué un tournant déterminant pour le Sénégal et plus particulièrement pour sa population rurale. Durant les années ’90, les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) se sont traduits par le désengagement de l’Etat, la privatisation des entreprises publiques chargées du développement rural, le transfert aux agriculteurs de certaines fonctions anciennement dévolues aux organismes publics, la réduction des subventions sur les intrants et le crédit agricole, la libéralisation des marchés et du commerce des produits agricoles. A la suite de la dévaluation du Franc CFA survenue en 1994, le pouvoir d’achat de la population, qui avait déjà accusé un affaiblissement progressif, s’est dégradé par une hausse des prix des denrées alimentaires. Les ménages pauvres, dont 70% des revenus sont consacrés à l’alimentation, ont vu leur ration alimentaire diminuer quantitativement et qualitativement. D’une manière générale, l’insécurité alimentaire s’est fortement accentuée. Le secteur primaire a enregistré un taux de croissance moyenne annuelle réelle de 1,3%, inférieur à la croissance démographique, qui est estimée à 2,9% par an. Des objectifs ambitieux ont été fixés par l’Etat, à savoir de résorber totalement le déficit en riz en 2012, par la valorisation des potentialités hydro agricoles de la vallée du fleuve Sénégal, de l’Anambé et toutes autres zones qui ont des potentialités productives. Les investissements étatiques et les potentialités en eau de la zone ont certainement attiré des acteurs étrangers à la localité, qui ont pu négocier l’obtention de terres à exploiter, par les paysans locaux ayant des difficultés pour une correcte mise en valeur de leurs champs (accords de sharecropping) ou avec les Communautés Rurales, là où le peu de terre était encore disponible. Les investisseurs de moyenne/grande taille, représentant l’agrobusiness, sont le phénomène le plus récent au niveau de la localité et constituent selon certains une véritable menace pour les équilibres socioéconomiques, écologiques et culturels de la Vallée. Cette perception est justifiée par le fait que les entreprises de l’agrobusiness, d’une manière générale, ont la tendance à réaliser des investissements fortement aléatoires (quand leur business n’est plus rentable ou moins rentable qu’ailleurs, elles peuvent rapidement abandonner le milieu), lourds (du point de vue environnemental et de la technologie utilisée), occupant des terres qui pourraient être mis en valeur par les paysans locaux, exploitant la main d’œuvre locale à des salaires infimes et envahissant le marché local avec des produits de mauvaise qualité (les produits agricoles les meilleurs étant destinés à l’exportation), en provoquant ainsi un bouleversement des prix au niveau du marché local. A cause de cela, il s’avère fondamental le rôle pouvant être joué par les producteurs locaux et leurs organisations, qui sont au cœur de tout processus de développement rural durable. Toutefois, pour atteindre les objectifs envisagés par l’Etat, fournir une contribution importante pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et garantir la croissance du milieu sur le moyen/long terme, certaines problématiques doivent encore trouver une solution, en particulier : L’ASESCAW et son intégration dans l’espace socioéconomique et politique local - 09 • le système d’approvisionnement en intrants peu performant du fait de la présence de plusieurs intermédiaires et de certaines pratiques commerciales (spéculation, sous évaluation des quantités, fluctuation des prix, etc). • le non-respect des calendriers culturaux, dû au manque d’organisation au niveau des organisations de producteurs, en particulier à la non-disponibilité d’intrants de qualité au moment opportun. • la faible performance du système de financement des banques classiques et des IMF pour faire face aux besoins de financement des campagnes agricoles. • la désorganisation du système de commercialisation, qui ne permet pas une bonne promotion des produits agricoles, les commerçants tirant en effet des grands profits par rapport aux producteurs. • la faible coordination entre acteurs financiers et autres intervenants de la filière agricole. La levée de ces contraintes, jointe à l’amélioration des capacités organisationnelles des producteurs, constituent les défis majeurs, afin d’augmenter l’efficience de ce secteur productif, en mettant l’accent sur l’amélioration des services à la production au début et à la fin de la chaîne productive. En ce sens les besoins auxquels les populations rurales de la vallée doivent encore faire face concernent le renforcement des organisations de producteurs existantes (en les aidant à atteindre le niveau d’organisation et de gestion d’une petite/moyenne entreprise agricole viable), la mise en place de structures coopératives génératrices de revenus qui réalisent des services à la production de qualité, le renforcement d’un dispositif d’accès au crédit adapté aux exigences du secteur. On parle ici de petits producteurs qui pratiquent une agriculture familiale quasi traditionnelle, caractérisée par des rendements encore insuffisants, par l’insécurité foncière, par la difficulté d’accès aux intrants pour la production, par la faible disponibilité d’infrastructures et d’équipements ruraux, par la faible diffusion de produits financiers adaptés, par l’orientation de la production en bonne partie vers l’autoconsommation, par la dépendance des acteurs externes (voir les commerçants). Face à ces difficultés, les stratégies d’adaptation des producteurs prennent la forme d’une extrême diversification de la production, l’intense recours à la main d’œuvre familiale (souvent non spécialisée), l’adhésion à plusieurs entités organisationnelles (tels que les sections villageoises, les foyers), l’exploitation autonome d’espaces culturaux à travers la création de Groupements d’Intérêt Economique (GIE) indépendants, la décision de chercher du travail rémunéré auprès des entreprises de l’agrobusiness ou d’accepter les conditions proposées par les investisseurs ruraux de la dernière heure. Le constat est que la participation aux foyers, donc à l’ASESCAW, n’est pas la seule pratiquée par les producteurs de la localité. Toutefois, les potentialités du système proposé par l’ASESCAW, qu’on va mieux analyser dans les chapitres suivants, constitue une réponse de plus en plus appréciée par les petits producteurs locaux, organisés autour des foyers et des groupements villageois et membres/clients des IMF et des magasins coopératifs. CHAPITRE 2 L’ASESCAW et son intégration dans l’espace socioéconomique et politique local L’ASESCAW et son intégration dans l’espace socioéconomique et politique local - 11 En gestation depuis 1965, l’Amicale Socio-économique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Walo (ASESCAW) est créée en 1976 et reconnue officiellement par l’Etat Sénégalais en 1978. L’ASESCAW a vécu au cours de son évolution des hauts et des bas. Elle doit sa survie aux changements opérés suite à sa longue « traversée du désert » causée par la Nouvelle Politique Agricole, initiée par l’Etat au début des années ‘80 et caractérisée par le désengagement de l’Etat et la libéralisation du secteur agricole1 . En réalité, cette politique, soutenue par les bailleurs de fonds, pour lesquels l’encadrement est jugé couteux et pas très profitable aux producteurs, fait suite au programme de redressement économique et financier mis en place en 1979. On assista, donc, à une libéralisation des filières, qui place la production rizicole au centre de l’activité économique dans le Delta du Sénégal. Tout ce bouleversement institutionnel a perturbé l’activité traditionnelle dans cette zone et des difficultés de respect du calendrier agricole se sont fait sentir. Dès lors, une nouvelle orientation s’est imposée pour corriger les imperfections du nouveau système. Cette orientation était axée sur le renforcement institutionnel des organisations de base, le renforcement de capacités des acteurs ruraux, la promotion d’une alternative au financement rural classique. Le tout centré sur un système participatif, évolutif et innovant, où le producteur, les OCB -Organisations Communautaires de Base - sont le cœur. A partir du Foyer de Ronkh, le village où ce processus de développement à la base a pris forme dans les années ‘60, bien avant le désengagement de l’Etat des activités productives, les jeunes paysans ont pris conscience que les sociétés d’encadrement n’étaient pas en mesure de les sortir de la situation de marasme socio-économique dans laquelle ils étaient. Ainsi, ils ont décidé de s’organiser autour de projets sociaux et hydro agricoles conçus et gérés par et pour eux mêmes. Cette expérience fut une réussite totale et fit tâche d’huile ; de 9 Foyers dans une collectivité locale au départ, ASESCAW compte aujourd’hui 176 Foyers et Groupements et couvre 12 collectivités locales, trois Départements, deux Régions. Le 9 janvier 1988, l’Etat du Sénégal l’agrée comme organisation non gouvernementale la base d’un protocole d’accord facilitant son action à l’endroit des populations rurales. L’ASESCAW s’est assignée comme mission d’assurer la formation des populations à la base dans différents secteurs d’activité, de lutter contre toute forme d’exclusion, de pauvreté, de dégradation des ressources naturelles et surtout contre l’exode rural qui est l’un des principaux soucis du Walo. Elle veut en outre promouvoir la sécurité et l’équilibre alimentaire dans sa zone d’intervention. Pour cela, elle s’investit dans l’accompagnement des associations villageoises (foyers ou associations villageoises) en les aidants dans l’élaboration, la conception, l’exécution et l’évaluation de leurs programmes de développement à la base. Cet accompagnement permet de stimuler des initiatives paysannes dans l’optique d’une recherche permanente d’alternatifs pour le développement du territoire. Aujourd’hui, ces fonctions sont assurées à travers une répartition suffisamment nette des tâches entre les différents niveaux de l’organisation. A la base, 1 les exploitations familiales adhèrent au niveau des villages aux foyers ou aux groupements villageois. Ces derniers remplissent plusieurs tâches, soit sociales soit économiques/productives. Elles réalisent des activités de promotion sociale et culturelle, mais sont aussi promotrices et coordinatrices d’activités génératrices de revenus réalisées par les membres. Ayant pu dans le temps obtenir des terres à exploiter, ces associations les mettent à la disposition des membres, tout en assurant des fonctions centrales pour la production agricole, concernant l’organisation des opérations culturales (identification des fournisseurs et des prestataires, achats groupés, définition des calendriers culturaux et des itinéraires techniques, gestion de l’eau pour l’irrigation, etc.). Les producteurs qu’y adhèrent se voient attribuer en début de campagne une parcelle sur laquelle produire, moyennant une somme correspondant aux frais d’exploitation (l’aménagement, la motopompe et tout autre service complémentaire mis à disposition par l’association, qui négocie à cette fin un crédit d’équipement avec les IMF du milieu). Tout en gardant la responsabilité individuelle du travail dans la parcelle qui lui a été attribuée (et du crédit de campagne emprunté pour les besoins en intrants), le producteur arrive à travers le foyer à opérer dans un cadre protégé, où l’accès à certains services est garanti (y compris l’appui/ conseil) et l’entraide est favorisée. Le riz et le maraichage, suivant les saisons et la programmation réalisée au sein des foyers, sont ainsi pratiqués, avec des résultats souvent meilleurs que dans les autres champs voisins, où les agriculteurs sont appelés à se débrouiller tous seuls. Chaque foyer (ou groupement villageois) est représenté au sein d’une « zone de l’ASESCAW », instance intermédiaire de l’organisation entre la base et la fédération, ayant comme espace de référence la Communauté Rurale d’appartenance, qui sert de relais de communication entre les deux. Au sommet de l’organisation on retrouve ainsi la fédération, à savoir l’ASESCAW, qui garde différentes fonctions, parmi lesquelles on peut citer, principalement, l’appui/conseil technique aux foyers (à travers son personnel technique), la représentation politique (à travers ses dirigeants) vis-à-vis des autres instances locales et nationales et la recherche de partenaires/ bailleurs avec lesquels développer des projets ou des initiatives spécifiques en faveur de la base associative. L’ASESCAW est aujourd’hui très engagée dans les différents espaces de représentation du monde paysan national et sous régional. Ses dirigeants sont à la tête des cadres locaux de concertation des organisations de producteurs (CLCOP) dans le Walo. Les cadres régionaux de concertation des ruraux (CRCR) de Louga et Saint Louis sont également dirigés par des leaders de l’ASESCAW. A cela s’ajoute la présidence de la Fédérations des ONG du Sénégal (FONGS), fer de lance avec le Cadre National de Concertation des Ruraux (CNCR) du syndicalisme agricole au Sénégal. Au-delà de l’adhésion aux différents espaces de concertation paysannes qui ont pris forme dans le temps au niveau du Pays, l’ASESCAW a développé aussi d’importantes synergies avec le pouvoir publique local. D’ailleurs, le Sénégal a entamé depuis les années Au début des années ’80, le Sénégal est confronté à une grave crise économique à laquelle a largement contribué l’échec de la politique agricole menée depuis l’indépendance. Les programmes d’ajustement misent sur la libéralisation des marchés et le désengagement de l’État pour stimuler la production et l’exportation des produits agricoles. 12 - Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz ’90 un vaste processus de décentralisation et de responsabilisation des populations à la base. Actuellement, l’exercice du pouvoir local se fait à travers les collectivités locales (conseils ruraux, conseils municipaux et conseils régionaux). Par ailleurs, des structures déconcentrées ont été aussi mises en place par l’Etat, sous la responsabilité des Ministères de compétence (on retrouve ainsi des Services régionaux, départementaux et communaux de l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation, etc.), censées garantir l’application des orientations gouvernementales au niveau local et de fournir un encadrement « sectoriel » au territoire et aux populations. Malgré la faiblesse des ressources humaines et financières disponibles pour mettre en œuvre les processus de décentralisation et de déconcentration prévus par la loi, il s’agit d’acteurs incontournables pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. Dans la zone du Delta, en particulier au niveau du Département de Dagana, l’ASESCAW a structuré dans le temps des relations étroites avec les institutions locales qu’on vient de citer. Il s’agit d’une concertation et d’une coopération stable et bidirectionnelle. D’un coté, toute intervention de l’ASESCAW doit être « validée » par le pouvoir publique local, sur la base des orientations qu’il a établi. A cet effet, des moments de confrontation et de partage, plus ou moins formalisés, sont organisés. De l’autre coté, cette concertation sert aussi à l’ASESCAW à faire valoir les idées et les intérêts de ces membres, en contribuant ainsi à la définition des politiques locales. La mise en place du PASA a confirmé cette orientation propre à l’OP : les collectivités locales de la zone d’intervention du projet (en particulier les Communautés Rurales) et les services techniques déconcentrés de l’Etat ont participé activement, dès le début, au processus. En plus, une stratégie de « pénétration » de plusieurs responsables de l’ASESCAW au sein des organes politiques des collectivités locales de la zone est une approche qui s’est affirmée dans le temps, afin de peser davantage sur les politiques de développement agricole du Nord du Pays. Par ailleurs, les relations partenariales entre l’ASESCAW et les autres acteurs de la localité ne se limitent pas aux pouvoirs publics. D’autres entités également centrales dans le cadre de la promotion socioéconomique de la zone ont été dans le temps ciblées par l’OP en tant qu’associés pour la concertation permanente et pour la mise en œuvre d’initiatives ponctuelles. Nous faisons référence ici à la SAED (Société pour l’Aménagement et l’Exploitation du Delta), d’antan chargée de l’encadrement des riziculteurs et de la coordination de la filière riz dans la Vallée, aujourd’hui chargée de la collecte de données sur la production agricole, de l’aménagement des grands périmètres et toujours disposant d’une forte connaissance de la réalité socioéconomique de la Vallée. Concrètement, la relation entre l’ASESCAW et la SAED a conduit à la mobilisation de personnes ressource de la Société pour des formations en faveur des membres de l’ASESCAW, mais aussi à un projet pilote de grand intérêt comme celui du Système d’Information des Marchés (SIM), qui sera mieux présenté dans le dernier chapitre. En effet, la diffusion de l’information sur l’évolution du marché agricole au niveau du Pays est un outil important, qui contribue à une meilleure décision sur quoi et quand produire chez les paysans. Cette attitude de l’ASESCAW à agir en tant qu’acteur du développement local (recherche de synergies, stimulation de la concertation, partage des informations avec les autres acteurs de la localité) est devenue au fil du temps partie intégrante de sa stratégie d’intervention. En effet, le type de collaboration développé avec la SAED est similaire aussi à d’autres entités du milieu, tels que l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), le Centre du Riz pour l’Afrique (l’ancienne ADRAO), le CGER (Centre de Gestion et Economie Rural) et d’autres. Cette approche est en train de permettre à l’ASESCAW une plus grande emprise sur le contexte dans lequel elle évolue et une meilleure valorisation de son rôle d’acteur du développement local. Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz - 07 CHAPITRE 3 Les services à la production agricoles 14 - Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve Dans le chapitre précédent le rôle et les fonctions des foyers et des groupements villageois qui adhèrent à l’ASESCAW ont été décrits. Il s’agit maintenant d’analyser ceux des IMF et des magasins promus par l’ASESCAW, qui opèrent en étroite relation avec les organisations des producteurs pour leur mettre à disposition des services agricoles essentiels, tels que l’approvisionnement en intrants, le stockage et la vente de la production (surtout le riz, étant moins périssable) et le financement des campagnes. En effet, l’ASESCAW a bien compris, durant les dernières années, la nécessité d’un coté de restructurer, redynamiser et renforcer les capacités de ses organisations à la base (les foyers et les groupements villageois) et, de l’autre, de déléguer à des structures appropriées et autonomes la gestion des services d’accompagnement à la production, comme l’approvisionnement en intrants et la commercialisation, mais aussi le financement des activités agricoles. Il s’agit dans ce cas de figure de formes organisationnelles de type coopératif et mutualiste (OP, IMF, centres commerciaux agricoles/magasins), disposant des caractéristiques suivantes: la diffusion de la propriété (on parle des sociétaires comme des stakeholders des institutions), la centralité de la personne (à la base de l’adhésion à la coopérative), le fonctionnement démocratique (à travers une représentation équitable des sociétaires dans les instances de décision et l’autogestion des institutions à travers les élus), le mutualisme (les services sont orientés aux sociétaires). Le financement agricole promu par l’ASESCAW : le dispositif Mec Delta L’appui à la mise en place de systèmes de microfinance viables et capables de financer l’activité agricole a été un des principaux objectifs des organisations de producteurs comme l’ASESCAW. Ce souci a été le résultat de l’analyse des limites du système bancaire local, basé sur l’action de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS), institution créée par l’Etat en 1987. Cette entité a montré dans le temps toutes ses difficultés à financer convenablement le développement de l’agriculture de la Vallée. Le manque de proximité entre l’institution et les paysans, sa faible connaissance des activités financées, le manque de produits financiers adaptés aux exigences des producteurs, la mauvaise attitude des producteurs vers ce « crédit étatique » (fortement politisé) et les difficultés organisationnelles internes à l’institution ont été à la base des résultats désastreux de la CNCAS en termes de taux de recouvrement et de qualité du service, ce qui a demandé à plusieurs reprises l’intervention de l’Etat pour couvrir les pertes. Face à cette situation, les premiers pas de l’OP en matière de financement rural sont allés dans la direction d’inclure au sein de l’organisation un dispositif rudimentaire de financement rural, dans le cadre de projets spécifiques, au bénéfice de ses membres. Les difficultés à garantir le recouvrement des prêts effectués, du fait de l’absence d’un cadre juridique permettant à ce genre d’organisations de réaliser des activités d’intermédiation financière et de l’approche « souple » de l’ASESCAW vis-à-vis de ses membres, a été à la base du non recouvrement d’une grande partie des sommes élargies. La décision de changer de stratégie a fait qu’à partir des années ’90 l’OP s’est beaucoup plus orientée vers la promotion d’entités ayant comme mission spécifique le financement des activités agricoles du milieu, sur la base des principes de la microfinance (crédits de proximité, peer pressure, adaptation des produits financiers aux besoins locaux, etc.). Encore une fois, à partir du village de Ronkh, où la première expérience a pris forme, on a assisté à la création 2 d’instituts financiers coopératifs et mutualistes dans toute la zone, appuyés par l’ASESCAW, mais autonomes du point de vue juridique et gestionnaire. Cette approche visait à trouver des solutions stables à la préoccupation de l’accès au crédit agricole et de la constitution d’épargnes par les producteurs. Parmi les entités financières ainsi créées, une attention majeure mérite la Mec Delta de Ronkh, qui a su dans le temps se positionner en tant que véritable alternative au système bancaire classique, en opérant selon les principes cités en haut, auxquels s’ajoute celui de l’articulation et de l’indissolubilité du lien entre les services financiers et non financiers. En effet, chaque institution financière (actuellement il y’en a sept) « possède » un magasin à coté qui, même si autonome du point de vue formel, opère en étroite collaboration avec l’IMF de référence2 , afin d’assurer les prestations mécanisées et la fourniture d’intrants aux bénéficiaires de crédits au niveau de la mutuelle en début de campagne. En même temps, à la fin de la campagne, c’est toujours le magasin qui s’occupe de récupérer la production agricole à un prix garanti (quand il s’agit de riz), pour la commercialiser à la période de l’année où les prix sur le marché sont plus intéressants. Le lien entre le crédit octroyé par l’IMF, la fourniture des prestations et des intrants et le recouvrement en nature du prêt est à la base du succès de la Mec Delta et des autres six institutions. En plus de ces services, les magasins octroient des subventions à la mutuelle durant les périodes de crises. De ce point de vue, ils représentent fondamentalement un bras économique pour la mutuelle. Ce système offre des garanties majeures en termes de recouvrement des crédits, efficacité des services, maitrise des activités financées, durabilité des institutions concernées et il a fortement influencé la proposition du modèle appuyé par le PASA, qui voit les IMF cités, les magasins y afférant et les organisations de producteurs travailler ensemble pour mettre à la disposition des producteurs ce dont ils ont besoin pour produire correctement. Du fait de l’importance de l’expérience développée au niveau de la Mec Delta, nous présentons ici de suite quelques éléments de son historique et de son fonctionnement. Créée le 13 mars 1993, la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Delta (Mec Delta) a porté le prolongement de la lutte du mouvement paysan du Delta pour un meilleur accès au crédit des populations rurales de la localité. C’est à la suite de la crise de la CNCAS et de la nécessité de développer un instrument financier efficace, fiable et autonome que certains membres du foyer de Ronkh ont décidé de s’organiser autour de la question du financement de leurs exploitations agricoles, afin de trouver des voix et moyens leur permettant de se prendre en charge. C’est ainsi qu’environ 70 personnes appartenant au foyer ont donné à l’époque une cotisation d’un sac de riz (le tout valorisé à l’époque à 300.000 Fcfa) qui posera le premier acte donnant naissance à un système de crédit revolving entre les membres du groupe. Le démarrage a été timide car les crédits octroyés étaient à la limite dérisoire par rapport aux millions de l’ancienne institution. Les dirigeants avaient une vision claire de la situation et ont ciblé les « laisser pour compte » de l’ancienne institution : les jeunes et les femmes. Les critères ne leurs permettant pas d’être éligibles, ces derniers étaient de fait exclus des financements. La nouvelle institution a donc démarré avec cette catégorie de clients, en leur octroyant des crédits d’un montant moyen de 50.000 Fcfa. Il faut se rappeler que le contexte de l’époque dans le Delta du Sénégal était marqué par la crise du remboursement. Il fallait dès lors faire comprendre aux producteurs qu’un crédit est pris Au niveau de la Mec Delta de Ronkh, le magasin s’est constitué formellement avec le nom de Delta Agriculture et Solidarité (Deltagrisol). Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve - 15 pour être remboursé. A ce propos, des stratégies ont été mises en place pour contraindre ces derniers au remboursement. C’est ainsi que le remboursement en public à été initié. Il s’agissait d’une mobilisation dans les marchés où les crédits sont effectués, ainsi que les remboursements. Personne ne voulait être la risée de la communauté et au risque de voir sa crédibilité entachée, les emprunteurs étaient contraints de rembourser. Il faut en outre remarquer que la Mec Delta a évolué de 1993 à 2000 dans l’informel. Elle a été agréée le 14 janvier 2000. Son territoire d’intervention qui était jusque là circonscrit dans le village de Ronkh s’est élargi à l’ensemble de la Communauté Rurale du même nom à partir de 2002. Cette extension de son domaine d’intervention a été possible grâce aux concours financiers favorisés par l’ASESCAW, notamment celui du FPE (Fonds Promotion Economique)3 , qui a permis à l’institution d’augmenter ses capacités de financement de l’agriculture. La légitimité juridique de l’institution ouvrant des nouvelles opportunités de refinancement et de parten ariat, la Mec Delta s’est progressivement spécialisée dans le financement de la riziculture, exploitant les niches de marché laissées par les nombreuses crises du système de crédit étatique. Des agences délocalisées dans le Département de Dagana ont été ouvertes, afin de garantir le maximum de proximité aux activités des producteurs et une couverture optimale de la zone cible. A travers le financement du Gouvernement Italien et, à partir de 2008, grâce au PASA, la CISV en partenariat avec l’ASESCAW a pu venir en aide à ce processus avec des investissements de taille concernant la construction ou la réfection des sièges des sept IMF du dispositif Mec Delta, tout en envisageant, sur le moyen/long terme, la création d’un véritable réseau d’IMF de la Vallée du Fleuve. La Mec Delta et les autres entités qu’y sont liées ont pour vision essentielle de devenir un système de financement rural socialement et financièrement performant, capable d’offrir des services financiers et non financiers diversifiés, en parfaite adéquation avec les besoins de ses membres pour transformer positivemen t le tissu économique local. Dans ce contexte, la mission déclarée du dispositif Mec Delta est d’offrir des opportunités de création de richesse aux couches démunies, par l’appui à la création et au renforcement de micro entreprises rurales, en mettant à leur disposition des services variés et pérennes. Enfin, elle vise la réduction des goulots d’étranglement du système de production, la réduction du taux de déperdition du crédit et de la production, l’amélioration significative du revenu du producteur et de son capital social et la sécurisation du crédit et de son remboursement. Une analyse approfondie du système dans les domaines clés qui fondent le succès d’un système de crédit agricole et rural révèle que : • Le dispositif Mec Delta (toute IMF confondue) dispose d’une assez bonne politique de ciblage des riziculteurs avec la décentralisation des services dans des guichets de proximité, une évolution positive et continue de la proportion de riziculteurs dans le nombre de bénéficiaire annuel de prêt (elle passe de 16,72% en 2005 à 39,06% en 2008) et un encours de prêt moyen qui assure toujours la couverture des besoins de crédit d’une exploitation rizicole de taille acceptable (deux hectares) même s’il évolue en dents de scie. La nature des garanties demandées et leur procédure de formalisation sont en adéquation avec les capacités des bénéficiaires. • La gamme de produits et de services proposés aux riziculteurs est diversifiée et prend en charge leurs besoins majeurs relatifs à l’accès au crédit de production et de petits 3 équipement, l’accès au marché d’approvisionnement et surtout aux prestations de services agricoles mécanisés même si le monopole des CCA n’est pas du goût de certains riziculteurs. Le mode de remboursement (riz paddy) est en bonne adéquation avec la préférence des riziculteurs et le suivi opérationnel de terrain donne des orientations techniques importantes. Cependant, il n’y a pas encore une bonne entente sur le prix au producteur avant le démarrage de chaque campagne agricole. • La gestion des risques liés à la stratégie d’intervention et à la méthodologie de crédit s’améliore d’année en année. En effet, de gros efforts sont déployés pour fixer un calendrier cultural et veiller à son application. Ainsi, les intrants sont libérés par tranche nécessaire au respect de ce calendrier. De plus, le crédit est remboursé en riz paddy bord champ avec prises en charge par les CCA des frais d’emballage et de transport. • Ce système, dont la mise en œuvre est un processus en cours et en évolution, a montré d’importants acquis qui peuvent être capitalisés pour des actions futures ou pour un élargissement du modèle à d’autres zones. • Les axes intéressés par le modèle touchent différents aspects du monde rural, notamment : 1. la promotion et la mise en synergie d’acteurs issus du monde paysan, à travers l’identification de mécanismes institutionnels clairs et appropriés ; 2. l’importance attribuée à l’appui organisationnel et institutionnel des acteurs locaux (OP, CCA, IMF) ; 3. la reconduction des principaux services à la production agricole aux instances représentatives des intérêts des paysans. Surement, certains défis sont encore à relever par les IMF du modèle, parmi lesquelles : • L’appropriation : Même si les acquis sont palpables et que le système productif de Ronkh ait révolutionné la culture du riz, il ne demeure pas moins que certains trouvent sa diffusion encore en dessous de leurs attentes. Certains usagers pensent que la sensibilisation fait défaut, ce qui se répercute sur le degré d’appropriation. Le projet PASA a joué un rôle important dans la sensibilisation en mettant en place un cadre de collaboration permanent ou les différents acteurs (OP, IMF et CCA) se réunissent pour discuter des problèmes du financement agricole. • Les infrastructures de stockage, qui doivent être renforcées pour baisser les couts d’accès aux intrants et pour limiter l’isolement des certains groupements de producteurs qui dénoncent des difficultés pour effectuer les déplacements vers les magasins actuellement disponibles. • La diffusion de la micro assurance : si à Ronkh le district productif a pu agir sur les risques en amont et en aval de la production grâce au système efficace mis en place, un autre risque récurrent menace toujours la production rizicole dans le Delta du fleuve Sénégal. Les risques naturels et au premier rang desquels l’invasion des oiseaux granivores. En 2006, la zone a enregistré une invasion d’oiseaux granivores qui ont détruit prés de 70% de la production. A cette époque, la Mec Delta était très engagé financièrement dans la campagne car à partir de 2003 tous les indicateurs étaient performants et les producteurs remboursaient correctement leurs crédits. Ceci a amené la Mec Delta à accroitre son niveau de financement jusqu’à atteindre 76% de son portefeuille. Tout ceci à cause de la bonne articulation du système mis en place qui a favorisé un bon taux de recouvrement du crédit. Crée le 22 novembre 1991 par le gouvernement du Sénégal, le Fonds de Promotion Economique (FPE) est une institution autonome dont la mission est de mobiliser des ressources à long et moyen termes auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qu’il met à la disposition des banques commerciales et autres intermédiaires financiers pour assurer le financement des petites et moyennes entreprises dans les différents secteurs de l’économie 16 - Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve En 2006 donc, arriva l’invasion des oiseaux granivores qui a causé des impayés massifs portant le portefeuille à risque à 36% avec des impayés traduits en perte. Les IMF du dispositif Mec Delta ont pendant trois ans souffert de cette situation. Grace à la mise en relation de la CISV avec l’organisation néerlandaise Terra Fina, la Mec Delta a pu participer à des cours de formation sur la micro assurance agricole, qui est perçue comme la seule alternative crédible à ces risques d’invasion d’oiseaux granivores. Ces types d’invasion sont fatals à une institution financière, parce qu’ils anéantissent l’épargne et attaquent le patrimoine de l’institution. C’est ainsi que les IMF du dispositif ont commencé à réfléchir sur les risques agricoles en général et les mécanismes de prévention. Après réflexion, l’option de la mise en place d’une mutuelle d’assurance agricole a été retenue. Seulement dans la réglementation sénégalaise, il n’y a pas de micro assurance, le code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance) ne le prévoyant pas. C’est pourquoi, l’idée a été de mettre en place un fond de solidarité agricole à la place. Ainsi est né le fond de solidarité agricole du Delta. L’objectif est d’arriver à en faire une micro assurance agricole à long terme et pour cela il faudrait que la réglementation évolue et permette ce type d’assurance. • L’expérimentation du warrantage : les IMF du dispositif Mec Delta se sont intéressées aussi au warrantage, qu’on peut définir comme un système basé sur l’octroi de crédits (d’une durée de 6 à 8 mois), dont la garantie est constituée par un stock de produits agricoles. Des expériences très intéressantes en la matière ont été développées par la CISV au Burkina Faso. Il s’agit en effet d’un système dans lequel un producteur (ou un groupement de producteurs) met en garantie sa récolte pour contracter un prêt auprès d’une IMF, pour lui permettre de résoudre ses problèmes familiaux du moment ou de mener des activités génératrices de revenues. D’une manière générale, le warrantage vise comme objectif la gestion optimale des productions agricoles par les populations rurales, en travaillant sur deux dimensions : a) Une dimension sociale en ce sens qu’il permet une sécurité alimentaire par la disponibilité de céréales qui sont récupérés par le producteur durant la période de soudure une fois le crédit remboursé. b) Une dimension économique parce qu’il permet aux producteurs de rentabiliser leur production : disponibilité d’argent à la récolte et meilleure vente de la production quand les prix augmentent. Le warrantage contribue ainsi à la réduction du phénomène du bradage des récoltes, au financement d’activités de contresaison (embouche, maraîchage), à la réduction de l’endettement en période de soudure, à la sécurité alimentaire en période de soudure, à la stabilisation des prix des céréales4. Les acteurs du modèle visent à exploiter les opportunités offertes par le warrantage, afin de trouver une solution efficace dans la commercialisation du riz et une première expérience pourrait être la prochaine étape. • L’éducation financière : pour la pérennisation du système décrit auparavant, la Mec Delta compte sur la sensibilisation des organisations de producteur sur une meilleure gestion des risques liés au crédit à travers l’éducation financière. • L’élargissement du système (réseautage des IMF) : les acteurs présentés dans le cadre de la description du dispositif Mec Delta ont aujourd’hui la volonté d’élargir le 4 5 système dans une zone géographique plus vaste, en incluant des autres sujets qui œuvrent dans le même domaine productif et culturelle. Ce dispositif Mec Delta « élargi » a été appuyé par le projet PASA et a été basé sur les acquis déjà en place et sur l’expérience maturée par l’ASESCAW et la Mec Delta. Pour aboutir à ce réseau du Delta, il s’avère nécessaire réaliser une large sensibilisation et adhésion de toutes les parties impliquées sur les avantages de la mise en place du réseau, mettre en place un cadre de concertation entre les différentes structures concernées (IMF, CCA, foyers/groupements villageois et ASESCAW) et favoriser les échanges d’expériences entre les membres du cadre. Les magasins/centres commerciaux agricoles (CCA) Les centres commerciaux agricoles sont des entités de type coopératif, qui prennent en charge des services à la production fondamentaux, tels que l’approvisionnement et le stockage/ transformation/commercialisation, en ligne avec les besoins et les contraintes des producteurs locaux. Les centres ont les caractéristiques et disposent des outils nécessaires pour fournir un service de qualité, adapté au milieu, durable et en synergie avec les acteurs chargés de la production en tant que telle (les OP) et les institutions chargées du financement rural. A travers cette stratégie, l’exploitant est au centre des préoccupations des acteurs du dispositif et peut bénéficier des services dont il a besoin pour conduire avec succès son exploitation agricole. Comme il a été souligné ci-haut, le dispositif s’appuie sur une méthodologie de crédit par laquelle tout le processus de mise en place du crédit est réalisé en nature (semence, carburant pour les motopompes, engrais, herbicide) ou sous forme de prestation de services agricoles mécanisés (réfection des aménagements, offsetage, moissonnage, etc.) avec les engins dont disposent les CCA. La première de ces entités qui a commencé à fournir ces services a été le Delta Agriculture et Solidarité (Deltagrisol), un GIE mis en place en 2003. Il travaille en synergie avec la MEC Delta, lié à celle-ci par une fonction de sécurisation du crédit et par le souci d’offrir des services non financiers de proximité aux producteurs membres de la mutuelle : approvisionnement en intrants, prestations de services agricoles mécanisés, recouvrement de la production en nature et la commercialisation des produits en vue de solder tout compte. Son installation permet de sécuriser l’investissement (garantir un bon rendement grâce à des intrants de qualité et dans le respect du calendrier cultural) et d’assurer une commercialisation satisfaisante de la production pour les producteurs (en les protégeant des « bana bana5 »). Au début, cette entité devait être un démembrement de la mutuelle ce qui n’a pas reçu l’aval du Ministère des Finances, qui trouve qu’une mutuelle ne peut chapeauter une structure pareille. Cependant, la réglementation permet la possibilité de création d’entités utiles par les membres d’un système financier décentralisé. Cette disposition a été utilisée pour créer le Deltagrisol. Les autres IMF du dispositif Mec Delta (agences ou mutuelles proprement dites) se sont, elles aussi, dotées dans les années suivantes de CCA. Aujourd’hui, sept IMF et sept CCA sont ainsi opérationnels, en ligne avec les principes du dispositif Mec Delta. Par abstraction, nous pouvons considérer partie intégrante de ce dispositif aussi la Centrale d’Approvisionnement et Prestation de Services agricoles (CAPS), qui a été mise en place suivant un parcours différent (avec un contrôle beaucoup plus direct de la part de l’ASESCAW), mais qui est en train de se rapprocher aux autres CCA, surtout du point de vue opérationnel. In « Description de l’expérience de warrantage dans le sud ouest du Burkina Faso », CISV/Burkina Faso, 2010 Commerçants ambulants CHAPITRE 4 L’articulation entre les acteurs du modèle (OP, IMF, CCA) 18 - Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve Une fois analysés le parcours et les caractéristiques essentielles de l’ASESCAW et de ses foyers/groupements villageois, des IMF et des CCA promus directement ou indirectement par l’OP, il s’avère important considérer maintenant le modèle dans son ensemble, en insistant sur les synergies qui le caractérise et sur les avantages réciproques dérivant de cette collaboration. Nous avons déjà souligné que les foyers/groupements villageois, les IMF et les CCA sont des entités autonomes, issues du même milieu, ayant des rôles différents dans le processus productif, mais réalisant des actions complémentaires. D’une manière générale on peut dire que les IMF représentent le bras financier du dispositif, au service des membres des foyers/groupements villageois de l’ASESCAW, mais aussi tout producteur local qui décide d’y adhérer, alors que les CCA sont le bras économique. Le foyer s’insère dans cette dynamique en assurant l’encadrement technique des bénéficiaires des services de la mutuelle. En d’autres termes, ils s’occupent de la production en tant que telle. Les foyers/groupements villageois ont une mission sociale consistant à fournir des biens publics (construction de postes de santé, activités de reboisement, promotion de la culture locale, etc.), mais aussi une finalité d’appui à la production (renforcer les capacités agronomiques et d’organisation des exploitants, organiser les productions et assurer un suivi agronomique des périmètres, faire une pression sur les IMF pour obtenir des conditions meilleures d’octroi des prêts, accompagner les exploitants dans l’entraide à travers des mécanismes de garantie solidaire, etc.). Les producteurs sont motivés à adhérer aux foyers du fait de ces fonctions. En outre, vis-à-vis des IMF, les foyers/groupements villageois détiennent un grand atout, pouvant garantir un suivi rapproché des activités agricoles financées, en vue de la sécurisation du crédit. Pour les CCA, les foyers/groupements villageois et leurs membres représentent des membres/clients importants. Les IMF, par contre, ont des objectifs de rentabilité et de pérennité financière pour satisfaire durablement les besoins financiers de leurs membres, tout en gardant les principes de la solidarité et de l’entraide. Les IMF assurent le financement et une gestion correcte du crédit emprunté par les membres (donc aussi ceux des foyers/ groupements villageois). Les IMF ont un rôle d’intermédiation financière, c’est à dire collecter l’épargne des membres et leur fournir du crédit qui soit adapté à leurs besoins. Dans le cadre du dispositif, un contrat de prêt lie les IMF, leurs magasins et l’exploitant (individuel ou collectif) par rapport au décaissement et à l’approvisionnement par tranches en intrants et des prestations mécanisées faisant l’objet du financement, ainsi que les conditions de recouvrement. En annexe du contrat, tous les éléments fournis à l’exploitant sont retracés, indiquant les quantités, les prix unitaires, le montant total. Pour les IMF, toujours à la recherche de solutions pour verrouiller le système d’octroi de prêt du détournement d’objectif et préoccupées de la bonne réussite de l’activité financée, la présence d’organisations de producteurs efficaces comme les foyers est une garantie importante. Par ailleurs, les couts soutenus par les IMF de suivi des activités financées de cette manière baissent, ce suivi étant en bonne partie assuré par les foyers mêmes. En plus, la fonction des IMF ne se limite pas au financement des campagnes, mais s’étend au refinancement des CCA. En effet, ces derniers ont souvent besoin de liquidité pour l’achat de nouveaux stocks d’intrants, de nouveaux engins ou d’autres nécessités liées au développement de la structure. Ces besoins peuvent être satisfaits par les IMF, qui sont en mesure (en s’appuyant éventuellement sur le marché financier) de garantir les fonds nécessaires. Les CCA représentent le bras économique du système. Etant chargés de gérer l’approvisionnement en intrants, de réaliser les prestations mécanisées, de collecter et de stocker les sacs de riz (paddy) sous forme de remboursement en nature du crédit des IMF, de vendre le stock cumulé en fin de saison, les CCA assurent une fonction essentielle, à plusieurs niveaux. D’un coté, ils permettent l’approvisionnement à temps en intrants des producteurs (celle qui constitue une des contraintes majeures pour les paysans) et avec des produits de qualité. Cet aspect est central soit pour le producteur, qui veut produire et rentabiliser son crédit, soit pour l’IMF, qui veut voir le crédit octroyé remboursé en fin de campagne. Par ailleurs, ces crédits sont considérés comme étant remboursés dès que l’équivalence en sacs de paddy est collectée et stockée dans les magasins/ centres commerciaux agricoles, sur la base d’un prix de collecte établi en début de campagne entre les IMF, les OP, les magasins/centres commerciaux agricoles et les exploitants. Cet aspect est très important pour le producteur, qui n’est pas obligé de brader sa production et/ou de perdre du temps pour l’écouler. A la fois, le crédit étant ainsi remboursé, il peut dans un bref délai prétendre à un nouveau crédit chez l’IMF et démarrer rapidement une nouvelle campagne (la proximité d’une campagne à l’autre étant un facteur de blocage pour la plupart des producteurs). Les CCA sont aussi chargées de commercialiser les produits stockés à une période favorable, sur le marché national, pour avoir des gains plus intéressants et rentabiliser l’opération. Après avoir vendu l’intégralité du stock, les CCA transfèrent aux IMF le remboursement en espèces du capital et des intérêts liés. Sur ses opérations commerciales, les CCA réalisent des bénéfices considérables (à peu près les 3% de la transaction financière). Annuellement, une partie des bénéfices ainsi produits et des excédents des IMF est utilisée pour subventionner certains investissements (travaux d’extension des IMF, ouverture de nouveaux guichets dans d’autres villages, aménagement de magasin et d’aires de stockage, etc.) et pour faire des investissements à caractère social, pour la communauté (activités pour les handicapés, fourniture de moustiquaires imprégnées, équipement pour les postes de santé, etc.). L’articulation entre les acteurs du modèle peut être représentée comme suit : CHAPITRE 5 Le Système d’information de marché (SIM). Organisation, utilités et perspectives 20 - Le contexte et les problématiques agricoles majeures de la Vallée du Fleuve Depuis toujours, la question de la commercialisation des produits agricoles et la pénétration des marchés constituent pour l’ASESCAW une préoccupation majeure. Compte tenu de la vivacité des marchés agricoles et des fluctuations des prix, la disponibilité constante par le producteur d’informations sur les prix et sur les demandes des produits, peut lui permettre d’augmenter ses revenus, en choisissant les solutions plus appropriées pour la production (quand et quoi produire) et la commercialisation de ses produits (où vendre). Pour cette raison, le Système d’information de Marchés (SIM) est considéré un outil important et qui peut s’adapter aux nécessités et aux caractéristiques de la zone cible. Produire, c’est une chose, mais avoir un marché où écouler en est une autre. Cette phrase à caractère de slogan, doit orienter les acteurs locaux, afin que les producteurs puissent valoriser leur production et réellement vivre de leurs activités. Ce système vise à mettre en place un dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des informations qui peuvent donc favoriser l’élaboration de stratégies commerciales et la prise des décisions appropriées par l’ensemble les producteurs. Même s’il est difficile de couvrir de vastes zones avec un réseau de points focaux et de financer le SIM sur le long terme, il s’agit d’un système d’information agricole qui peut bien s’adapter aux besoins des producteurs et qui doit être pris en charge pour son implantation par les organisations paysannes qui maitrisent les territoires et les besoins en information. Dans le cadre du PASA, l’ASESCAW et la CISV se sont inscrites dans une dynamique d’expérimentation du système, en mettant en place un mécanisme de transmission d’informations et d’affichage de données relatives aux produits agricoles, tels que le riz et les produits maraichers, répartis au niveau des différentes zones. Dans le souci de garantir aux producteurs des services de qualité, le Système d’Information de Marché (SIM) permet aussi d’améliorer les échanges d’informations sur les évolutions du marché (prix, intrants, quantités, sites, etc.) et de renforcer les capacités techniques des organisations de producteurs. Les actions d’appui à la commercialisation sont basées sur la mise en place d’une cartographie des grandes zones de production et de mise en marché, outre que des conseils aux producteurs. Ce dispositif se base sur une observation permanente des tendances des marchés et sur une information des producteurs sur les opportunités offertes, ceci en relation avec la programmation de la production. Afin de mettre en place le SIM, des étapes ont été réalisées : - détermination des besoins informatifs des producteurs; - enquête auprès des agriculteurs pour déterminer le type d’informations souhaitées et quels produits inclure dans le système; - identification des marchés et des points de collecte des informations Outils pour l’organisation des services agricoles de proximité en faveur des producteurs de riz - 21 - installation et équipement de Points Focaux et choix des personnes chargées de leur gestion; - identification des personnes ressources qui ont la tâche de récolter les informations Le dispositif consiste à l’utilisation des magasins de la zone qui servent de points focaux du système. La première phase a été entamée avec un nombre de dix points distribués dans tout le Département de Dagana, ce qui a permis d’avoir des produits divers et variés et des informations significatives sur les prix. Chaque point est doté d’un téléphone portable et d’un tableau d’affichage des informations. Le système se base sur la transmission des informations par téléphone, gérée par une personne ressource interne (opérateur) de l’institution propriétaire, identifiée à cet effet. La personne identifiée a été aussi formée sur les procédures de fonctionnement établies à l’intérieur d’un manuel, partagé entre tous les acteurs du système. Chaque point focal détient le répertoire téléphonique de tous les points du « réseau ». Ainsi s’établie la connexion. Le circuit de l’information démarre des personnes ressources qui remontent les informations sur les prix et les produits (apprises auprès des marchés et des producteurs de la zone) aux points focaux. Cet échange d’informations des personnes ressources aux responsables des points focaux se réalise de manière orale (compte tenu de la proximité entre les marchés et les structures identifiées) ou par SMS. Les points focaux remontent ensuite l’information au centre du système en utilisant les téléphones portables ou, si possible, l’internet. Une fois collectées et consolidées, les données complètes sont envoyées à nouveau aux points focaux qui mettent enfin à jour le tableau d’affichage. A la fin de ce cycle de passage d’information, les producteurs et commerçants peuvent disposer, au niveau des tableaux d’affichage de chaque point focal, des données dont ils ont besoin concernant les produits de leur localité et d’ailleurs. Les informations que le système permet de collecter sont donc les suivantes: • Demande et offre des produits (y compris les intrants) ; • Stocks disponibles au niveau des différentes zones ; • Prix de marché. Le centre du système étant au niveau de l’organisation paysanne, elle est chargée du dispatching de l’information vers les points focaux et elle doit jouer le rôle de référent pour tous les acteurs qui participent au SIM et pour tous les sujets qui peuvent être intéressés par le système, étant donc le canalisateur pour ce qui concerne sa zone d’intervention. Compte tenu de leur rôle dans le cadre de la commercialisation de la production et des intrants, l’implication des CCA dans le dispositif est en cours d’évaluation. CONCLUSION Le PASA s’est activé dans le renforcement d’un modèle, qui, en tenant compte du contexte socioéconomique de la localité et à partir des principales contraintes identifiées et des besoins exprimés par les bénéficiaires, présente des caractéristiques fortement innovantes. En effet, l’action proposée a visé la structuration efficace et efficiente des organisations de producteurs les mieux enracinées dans le Delta, pour qu’elles puissent fournir un appui de qualité aux paysans dans la réalisation et la gestion des activités agricoles, en représentant mieux les intérêts vis à vis des autres instances économiques, financières et politiques, et collaborer d’une façon plus efficace avec les autres acteurs commerciaux et financiers émanant de la même base, pour identifier des solutions partagées. De l’autre coté, les IMF et les CCA, composés en grande partie par les mêmes membres des organisations de producteurs, améliorent au fur et à mesure leur niveau de performance grâce à des capacités gestionnaires, organisationnelles et financières assez élevées. Si l’autonomie de ces deux typologies d’acteurs a été toujours assurée, la collaboration et les synergies qu’ils ont développées au cours du projet ont permis d’améliorer l’environnement socioéconomique à l’intérieur duquel le paysan s’active. Les facilitations dans l’accès au crédit, l’établissement d’un circuit d’approvisionnement et de commercialisation bien huilé, la définition d’un calendrier cultural et d’outils de suivi efficaces, représentent des exemples importants des résultats de cette collaboration. L’ASESCAW, accompagnée par la CISV, est aujourd’hui en train ainsi de promouvoir un modèle productif/ organisationnel claire et innovateur, qui rompt avec certaines mauvaises pratiques du passé (financement, organisation de la production, commercialisation, etc.). Les organisations de producteurs sont en train de redéfinir leur mandat et leur structure, en s’activant pour arriver à une production agricole de qualité. Les services fournis à leurs membres, au niveau de l’organisation du travail sur le périmètre, de la gestion des biens et des activités communes (aménagement des périmètres, gestion de la motopompe, achats groupés, négociation des conditions d’emprunt du crédit, vente en stocks, etc.), permettent aux paysans (surtout les plus démunis) de dépasser les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. On souligne également l’existence d’un « potentiel associatif » énorme au niveau de l’ASESCAW, de ses foyers/groupements villageois, des CCA et des IMF. Le partage de problématiques et la recherche de solutions innovatrices, mais aussi adaptées à la localité, représentent des atouts forts que les membres de ces institutions développent à travers leur participation. S’agissant d’institutions démocratiques et mutualistes, elles assument le rôle de promotrices des intérêts de ses membres. A travers une action complémentaire et synergique au niveau du cycle productif, elles permettent aux paysans d’avoir une mainmise forte sur les différentes phases de la production et de bénéficier davantage de la valeur ajoutée de toute la chaîne productive.
Scarica